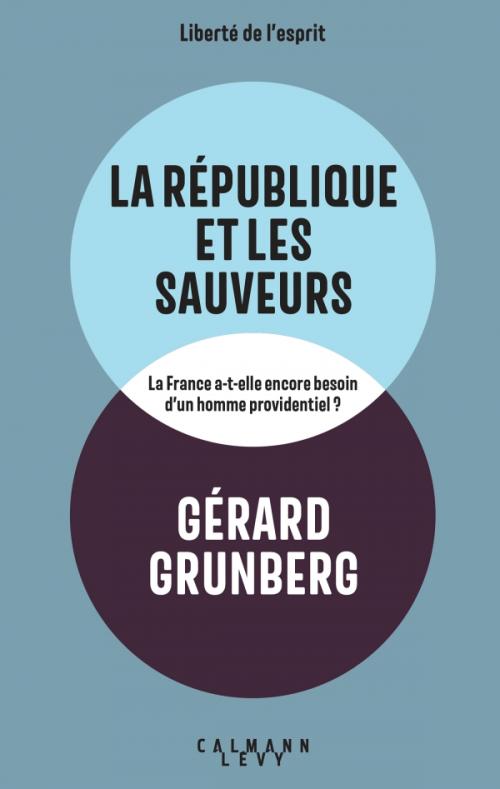La figure du « sauveur » est un mythe de la vie politique française comme l’avait mis en évidence l’historien Raoul Girardet, en 1990, dans un livre intitulé Mythes et mythologies politiques, qui se relit aujourd’hui avec profit, dans notre âge de « fake news »… Mais ce sont aussi des réalités. (a/s de Gérard Grunberg, La République et les sauveurs, Calmann-Lévy, 2022, 250p, 19€)
La notion a été un peu trop galvaudée, car elle est souvent utilisée pour des cas trop différents – il y a plus qu’un fossé entre Napoléon Bonaparte et Gaston Doumergue, le « sage de Tournefeuille » ! Gérard Grunberg veut penser plus rigoureusement ce que ce mythe et ces réalités disent de la politique française depuis 1789. C’est pour cela qu’il parle de « la République et les sauveurs », en réservant cette notion à ceux (pour l’instant ce ne sont que des hommes…) qui ont établi (ou tenté d’établir) un pouvoir personnel mettant en cause la République et les principes de la démocratie parlementaire de manière absolue ou relative.
Il se donne une clef de compréhension, en construisant un « modèle césarien », selon la méthode de « l’idéal- type » de Max Weber, qui demande l’existence d’une grave crise nationale, une demande d’ordre dans de larges parts de l’opinion, une personnalité « exceptionnelle », l’établissement d’un régime de pouvoir personnel et, le plus souvent, plébiscitaire, un État fort.
L’auteur examine cinq moments historiques où le régime républicain a été renversé ou mis en cause, avec la volonté d’instaurer de nouvelles institutions. Il s’agit, bien sûr, des deux Napoléon, le « grand » et le « petit », de la tentative boulangiste à la fin des années 1880, du maréchal Pétain et du général de Gaulle, qui a eu le privilège d’être un « sauveur » à deux reprises. Des analyses à la fois nourries par d’amples et synthétiques lectures permettent de voir les points communs et les différences, et de mener, en même temps, une réflexion sur la démocratie moderne et ses problèmes. Cet essai de science politique a également le mérite pour le lecteur de tracer des portraits pertinents de chacun des « sauveurs » étudiés.
Napoléon, le grand et le petit
Napoléon Bonaparte est celui qui a incarné pleinement le « modèle césarien ». Il a, en effet, imposé une « monarchie populaire » en vidant de leur sens les institutions représentatives. Et, tout à fait sciemment, il a fait reposer sa légitimité sur la « gloire militaire ». Il a réduit toutes les oppositions et limité strictement toutes les libertés publiques. La seule liberté qu’il a favorisée a été celle des propriétaires. L’affermissement d’un État puissant et centralisé a été son principal legs. Mais son régime s’est épuisé lui-même au fil des défaites militaires. Et la concession qu’il a faite au régime représentatif dans « l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire » pendant les Cent jour n’était qu’une tactique contrainte. Son plus grand succès a été d’avoir lui-même forgé sa légende qui a pesé sur le cours de l’histoire ultérieure et a donné naissance à un tempérament politique, le « bonapartisme ». Napoléon III a commencé par mettre ses pas dans ceux de son oncle. Mais il était plus anti-parlementaire qu’anti-libéral comme Napoléon Premier. Cela rend compte de l’acceptation progressive de l’évolution libérale du Second Empire qui a réalisé, finalement, un compromis avec le régime représentatif dans ses dernières années. La défaite militaire – le neveu rejoignant l’oncle – a scellé sa fin. Mais il a laissé un problème qui n’a cessé de se reposer sur la nature des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L’ échec rapide du « boulangisme » aurait pu l’écarter de cette étude. Mais l’auteur a eu raison de s’y attarder quelque peu. Car s’il n’a pas eu d’héritage institutionnel, le « boulangisme », victime en partie de la médiocrité de son incarnation, a été le moment où s’est forgé un nouveau nationalisme populaire qui, par la suite, s’est prolongé peu ou prou, dans toutes les contestations populistes des extrêmes droites.
Pétain et de Gaulle
Les chapitres consacrés à Pétain et à de Gaulle sont évidemment importants et éclairants. Il y a une différence majeure entre ces deux « sauveurs », Pétain est précédé par sa « légende », de Gaulle l’a crée dans l’épreuve. L’ambition du vieux maréchal était réelle, et il n’a pas été le dernier à se plonger dans les intrigues qui ont mené au 10 juillet 1940 et à la constitution de l’État Français. Mais, en même temps, il a été un objet de manœuvres et a perdu, peu à peu, son emprise sur les évènements. L’ auteur a donc raison de parler plutôt du régime de Vichy qui a été profondément réactionnaire, en rejetant les principes mêmes de la Révolution française et la légitimité du suffrage populaire. Son nationalisme a été fait d’exclusions – avec les juifs au premier rang, alors que le bonapartisme avait une vision inclusive de la nation. De toute manière, la Collaboration a été sa « tunique de Nessus » et le régime a été emporté avec la défaite de l’Allemagne. Et de « sauveur », Pétain en est venu à incarner la figure du traître à la Nation.
De Gaulle, lui, venu du fond de la crise française la plus grave du XXe siècle, a largement contribué à rebâtir une fierté nationale à travers les épreuves les plus dures. Il n’était certes pas un démocrate et avait condamné le parlementarisme et les partis politiques, diviseurs de la nation, qui avaient à ses yeux une grande part de responsabilité dans le désastre de 1940. Son but, tout au long de sa carrière politique, fut d’établir un pouvoir exécutif fort, incarné par un « chef », puisant sa légitimité dans un peuple rassemblé. Les réalités et les rapports de force – et de Gaulle fut aussi un grand pragmatique – l’ont amené à conclure des compromis avec les principes du régime représentatif, dans la Résistance, avec les partis politique pour conforter la France libre, à la Libération, avec les Assemblées, pour un temps, en 1958, pour faire accepter un quasi coup d’État avec, encore, une constitution qui consacre un régime « semi- présidentiel » ou « semi- parlementaire ». Mais, à chaque fois, il a voulu réaffirmer son projet fondamental, la prééminence du chef de l’État, avec toutes ses conséquences : en 1946, quand il rejette le compromis de la Libération, et l’année suivante, quand il crée le Rassemblement du peuple français ; en 1958, quand il fait légitimer par référendum l’élection du président de la République au suffrage universel, et donne ainsi sa véritable base à la Ve République. Il a dû concéder la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale (donc, le rôle du Premier ministre), mais, dans la pratique, il a toujours fait en sorte que le chef de l’État soit la source exclusive du pouvoir exécutif.
Gérard Grunberg note finement les contradictions de cette nouvelle République et la lutte d’influence avec le Premier ministre, Georges Pompidou, choisi comme un simple « collaborateur » au début, qui ne commence pas qu’en mai 1968… Deux lectures de la Ve République s’opposent en fait, celle de De Gaulle, plébiscitaire, minorant le rôle des partis politiques, celle de Georges Pompidou qui ne se voyait pas comme un « sauveur » – il le pensait, lucidement, impossible après le général de Gaulle – mais comme l’expression d’une majorité présidentielle, éprouvée au Parlement. L’issue du référendum de 1969 était inscrite dans les contradictions de la Ve République qui a échappé à son créateur.
Macron et le pouvoir personnel
Le livre s’achève sur l’étude du macronisme, cet « objet » toujours « non identifié »… Emmanuel Macron, dans sa « prise du pouvoir », a été comparé à plusieurs reprises à Bonaparte par des analystes et des commentateurs. Il est vrai qu’il a mis à profit la crise des partis traditionnels de gouvernement, le Parti socialiste surtout, mais aussi, dans une moindre mesure, Les Républicains, qu’il a aggravée par sa volonté de brouiller le clivage entre la gauche et la droite. Sa revendication d’une « verticalité » du pouvoir ne fait pas de lui un démocrate libéral.
S’il a mené une politique économique en partie néo-libérale jusqu’à la crise du Covid, il reste attaché au rôle éminent de l’État, négligeant les corps intermédiaires, minorant les partis politiques, se contentant d’un mouvement derrière sa personne. Mais, et l’auteur insiste, il est loin d’être vu comme un « sauveur » mais comme un président de la Ve République, adepte du pouvoir personnel, partisan, plus qu’il ne rassemble. Il a renoncé à réformer les institutions, contrairement à ce qu’il avait annoncé, et a finalement usé et abusé de toutes les ressources de la présidence. Son « populisme ligth » n’entre pas en adéquation avec la nature sociologique de ses soutiens.
Ce constat fait, on peut cependant ajouter aux réflexions de l’auteur un point – qui ne concerne pas qu’Emmanuel Macron. La présidentialisation, voulue par le général de Gaulle, amène dans de larges parts de l’opinion à sinon tout attendre du président, du moins beaucoup… Tout continue de remonter à lui et personne ne pense que les grandes décisions (et parfois de plus petites…) ne dépendent pas de ses choix. C’est à l’évidence une raison de l’affaiblissement de la sève démocratique dans notre pays, et cela entretient le cycle des attentes et des déceptions.
Alain Bergounioux