Dans la continuité des réflexions initiées dans son précédent ouvrage consacré au populisme (Peuple souverain, L’OURS 473), l’historien Pascal Ory, président de l’association pour le développement de l’histoire culturelle, propose dans son dernier livre une histoire mondiale de la nation (Gallimard). Il répond à nos trois questions, et Alain Bergounioux a lu son livre pour nos lecteurs.
Qu’est-ce qu’une nation ? Et qu’est-ce qui caractérise ce que vous appelez l’« identité » de la nation française ?
Ma réflexion ne porte pas spécifiquement sur la France. La réponse que je donne à la question que je pose est donc, pour moi, universelle : « un peuple qui devient le Peuple ». En d’autres termes : à la base une identité culturelle (un système symbolique autonome, associant deux langages : le langage linguistique et le langage rituel, dit « religion »), résultante d’une expérience politique, qui fait, comme dirait Leibnitz, qu’il y a « quelque chose » plutôt que « rien », autrement dit des Tchèques et des Slovaques, des Autrichiens et des Slovènes, plutôt que, par exemple, seulement des Moraves ou seulement des Hongrois ; et au sommet le croisement de cette identité avec la grande révolution politique des temps modernes, j’ai nommé la souveraineté populaire (le Peuple), qui naît en Occident – ce qui explique que les mouvements de libération nationale extra-occidentaux sont toujours des « retours à l’envoyeur ».
L’identité française, dans tout ça, se caractérise par des traits remontant au temps du « peuple » – une expérience politique ancienne, continue, unitaire, où le centralisme monarchique se conjoint au centralisme catholique – et par une manière originale d’accéder à la modernité politique du Peuple : alors que les trois révolutions fondatrices (Provinces-Unies, Angleterre, États-Unis) s’adossent à la religion (protestante), la quatrième révolution, la française, s’oppose frontalement à la religion (catholique). La focalisation française sur la laïcité est le fruit de ce particularisme.
Quelle est la relation de la gauche à la nation puisque vous dites que « la gauche a inventé la nation et l’internationalisme » ?
Fondée sur le postulat de la souveraineté populaire, la nation est évidemment par ses origines « de gauche ». Ses adversaires sont les tenants des anciens régimes politiques : souveraineté transcendante et autorité dynastique. Aujourd’hui l’État nation est devenu le modèle standard : sur les 193 États réunis au sein de l’ONU – intitulé inexact puisqu’elle réunit non des nations mais des États – seule une petite poignée fonctionne encore sur le modèle d’ancien régime, au premier rang desquels, son nom le dit assez, l’Arabie « saoudite ».
Mais cette victoire s’est payée d’un déplacement des enjeux de l’extérieur vers l’intérieur des pays ayant réglé leur auto-institution nationale : la France, qui a inventé la démocratie autoritaire moderne avec Napoléon Bonaparte, invente aussi, à la fin du XIXe siècle, le « nationalisme », qui rapatrie vers une droite de ce fait extrémisée – et populaire – le principe national pour régler ses comptes avec les « métèques », les juifs ou les francs-maçons mais aussi avec une nouvelle gauche, dont l’hégémonie passe progressivement à l’internationalisme ouvrier. Cette hégémonie s’est effondrée après l’échec des successives expérimentations internationalistes, échelonnées de 1917 à 1989. Le populisme – auquel j’ai consacré mon livre précédent – naît des épuisements successifs de l’ère progressiste, puis de l’ère libérale. C’est une recomposition politique, analogue au nationalisme d’il y a un siècle : une droite radicale dans un style de gauche radicale. Voilà pourquoi dans ma définition il ne peut y avoir de « populisme de gauche », simplement une gauche radicale tentée par l’extrémisme symétrique et qui, selon les circonstances, bascule ou pas.
Vous dites que la nation « a encore de beaux jours devant elle » : pourquoi ? Et ne risque-t-elle pas de disparaître, « incapable de faire face au triple enjeu – écologique, économique et culturel » qui marque notre époque ?
Comme la lecture politique qu’on est amené à faire de la pandémie le montre assez, le national continue à être la première ressource des « peuples ». Au reste, l’année 2020 a été à la fois celle du virus et celle du Brexit. Les deux radicalismes, de droite et de gauche, qui ont toujours attaqué symétriquement l’Union européenne ont, de ce fait, fragilisé la seule tentative moderne d’essai d’un état supranational. Quant à l’international, il s’est révélé une « communauté imaginée » tout aussi « construite » que le national : toute institution politique se fonde sur une mythologie : l’État-nation, bien sûr, mais le mouvement ouvrier ou l’anarchisme tout autant… Seulement, à l’usage, c’est l’international qui s’est déjà effondré, pas le national. Le grand malentendu présent porte sur la notion de mondialisation : ce phénomène technologique, économique et culturel n’a pas fait avancer d’un millimètre le « mondialisme » ; son accélération, à partir du XVIe siècle, a, au contraire, produit dialectiquement la forme nationale.
L’échelle des enjeux écologiques à venir produira peut-être un internationalisme de sauve-qui-peut, mais tout aussi probablement des refuges de démocratie autoritaire ou totalitaire. La synthèse des deux s’est appelée au siècle dernier l’URSS… La question des prochaines décennies serait alors moins celle de la nation que celle de la dictature.
Propos recueillis par Isabelle This-Saint-Jean
Force et résistance de l’idée nationale, par ALAIN BERGOUNIOUX
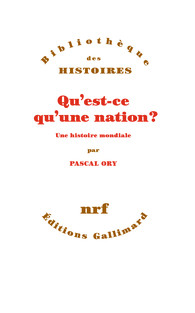
Ce livre, qui reprend le titre de la célèbre conférence d’Ernest Renan,veut présenter une histoire mondiale de la nation. Il relève, initialement, d’une interrogation personnelle de l’auteur qui, dans les années 1970, jeune historien socialiste, considérait la nation comme une réalité quelque peu dépassée et qui, maintenant, constate la force de l’idée nationale et sa résistance dans la mondialisation. (a/s de Pascal Ory, Qu’est ce qu’une nation ? Une histoire mondiale, Bibliothèque des histoires, Gallimard, 2020, 460p, 28€)
Le monde de 2020, selon lui, ressemble plus à celui de 1919 qu’à celui de 1945. Pour comprendre ce que Marcel Detienne appelait une « énigme »1, Pascal Ory entreprend, d’abord, de mettre au jour les fondements de l’idée nationale, de décrire, ensuite, les manifestations qui ont construit et conforté les nations, de s’interroger, enfin, sur les problèmes des nations, leurs « fortunes », leurs « infortunes » et leurs « incertitudes ». Cette ambition est nourrie par de nombreuses années de recherche et de séminaires, et par toute une série d’ouvrages égrenés depuis la fin des années 1970. Les multiples analyses et études de cas permettent au lecteur de se livrer à un passionnant et étourdissant tour du monde des nations.
Une théorie du fait national
Mais les fils directeurs sont clairs et donnent – sans que l’auteur ne le revendique explicitement – une théorie du fait national. Le parti pris est net. Pascal Ory considère que cela n’a pas beaucoup de sens de traquer les aspirations d’un esprit national dans un passé lointain (tant pis pour le Dimanche de Bouvines…). Il privilégie la « modernité » occidentale, du XVIe au XIXe siècles, avec l’apparition et la consolidation des États, où « un peuple » devient, peu à peu, « le Peuple ». Certes, très tôt, les individus se sont attachés aux communautés dans lesquelles ils vivent, les clans, les tribus, les cités. Mais les identifications culturelles et religieuses ne suffisent pas pour former une nation. C’est le politique, dans des processus longs et variés, qui forge progressivement une réalité nouvelle, institutionnelle et émotionnelle, qui mobilise à son profit les ressources culturelles préexistantes et en crée d’autres. L’auteur rejette, ainsi, les explications « infrastructurelles ». Le fait national déborde le capitalisme, même si un certain nombre de conditions économiques – la formation d’un marché notamment – sont nécessaires, sur lesquelles on peut considérer que l’analyse manque malgré tout.
Le vrai moment de rupture, pour cette histoire, se situe avec les quatre révolutions « modernes », l’indépendance des Pays-Bas, à la fin du XVIe siècle, la « Glorieuse » révolution anglaise au XVIIe, et les révolutions américaine et française au XVIIIe, où se constituent des peuples souverains, reposant sur un « contrat de volontés » qui a un caractère de « fiction » mais qui n’est pas « fictif ». Pour Pascal Ory, on ne peut vraiment parler de nations qu’avec les États nationaux démocratiques – quelles que soient les limites de ces « démocraties » – qui font de la nation un espace délimité, capable d’intégrer ses populations, et de coopérer avec d’autres États nations et de les affronter autant que de besoin.
Une idée neuve en Occident…
Les origines du fait national sont bien occidentales, « une idée neuve en Occident » est-il écrit. Les XIXe et XXe siècles en ont vu, ensuite, une mondialisation, par une acculturation qui a procédé à la fois par une contagion de la liberté des peuples et des individus, et par les effets de la colonisation, qui a concerné une bonne partie du monde, et donc, de la décolonisation qui a engendré de multiples nations et des mouvements nationaux qui n’ont pas connu le succès. Les processus ont été divers et contrastés, selon les rapports de force (toujours l’explication principale par le politique). Mais le sens de cette histoire est clair.
La seconde partie de l’ouvrage passe en revue les différentes manières de construire et de consolider le fait national : la délimitation d’un territoire, avec la question des frontières ; le choix d’un nom ; l’adoption d’une langue (plus rarement des langues), avec divers cas de figure, d’une langue installée, reconstituée, adoptée (avec la colonisation), ou construite (avec le passionnant exemple de l’Hébreu) ; la place complexe des religions, ressources pour les nationalismes (et les populismes aujourd’hui ), mais qui peuvent aussi « recruter » les sentiments nationaux à leur service ; les récits et les « romans nationaux » avec, plus généralement, les politiques culturelles.
Tensions
Pascal Ory note, justement, qu’il n’y a dans le fond actuellement qu’une seule véritable alternative au fait national et qu’elle se trouve dans le monde musulman, où l’islamisme ne conçoit d’État que religieux. Mais, pour le reste, la nation demeure : elle a survécu à l’idéologie communiste qui, dans le cas de l’URSS, avait bien du mal à camoufler le « chauvinisme grand-russe », comme le disait Lénine lui-même, et résiste à la mondialisation libérale, apparaissant même comme un rempart aux yeux de beaucoup. Cela dit, les contradictions sont aussi nombreuses. Des exemples récents d’éclatement d’États nationaux sont en mémoire, ne serait-ce qu’en Europe, avec la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, l’un dans le drame, l’autre dans le consentement. Des tensions plus ou moins fortes existent en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie, en France même. Une plus grande hétérogénéité culturelle et religieuse dans les sociétés européennes rend plus difficile l’homogénéité politique. Des régimes populistes – en Inde actuellement – mènent des politiques discriminatoires contre leurs minorités. Dans des régimes dictatoriaux, une répression dure se manifeste, comme en Chine contre les Tibétains et les Ouïgours.
Le fait national est loin de n’agir que dans le sens de l’émancipation des individus. Il a un côté noir, les guerres sont là pour le montrer, et peut trahir ses promesses initialement démocratiques. Pascal Ory n’évite pas la question. Il distingue deux grands types de nationalisme, le premier intégrateur, le second excluant. La réflexion aurait pu être plus approfondie sur ce qui peut, notamment, faire passer de l’un à l’autre. Il est un peu étonnant aussi que les réalités et les problèmes de l’Union européenne ne soient que mentionnés rapidement. Car « cet objet non identifié » (Jacques Delors) repose, certes, sur des États nations, mais il comporte une dimension originale qui amène à poser différemment la question du fait national. Le débat fait rage sur cette question et ne cessera pas de sitôt. Pascal Ory paraît s’en tenir à une ligne moyenne qui refuse le projet nationaliste qui méprise les individus et les droits, et le projet internationaliste qui ne prend pas en compte la souveraineté populaire. L’énigme nationale n’est donc pas tout à fait résolue…
Alain Bergounioux
1 – Marcel Detienne, L’identité nationale, une énigme, Gallimard, Folio, 2010.

