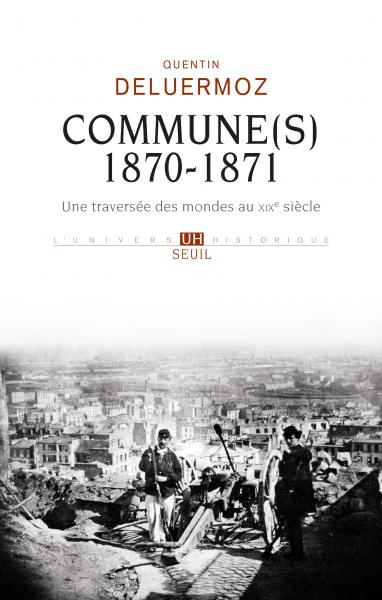Le livre de Quentin Deluermoz propose une approche originale qui vise à replacer les semaines de pouvoir communaliste dans des perspectives plus larges, prenant en considération son inscription dans l’histoire des révolutions, les échos qu’il a pu rencontrer dans le monde, tente aussi d’y examiner la vie sociale et, enfin, aborde les traces qu’il a pu laisser dans les imaginaires. A propos du livre de Quentin Deluermoz, Commune (s) 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Le Seuil, 2020, 299p, 25€. Article paru dans L’OURS 508, mai 2021.
Le 150e anniversaire de la Commune de Paris, comme lors de son centenaire, est l’occasion de multiples (re)publications1 qui viennent le plus souvent entretenir les légendes nées du mouvement parisien. Ce n’est pas le cas ici.
À une époque où se sont développés les moyens de communication qui permettent à la presse et aux premières agences internationales d’en rendre compte presque en temps réel (l’achèvement du câble transatlantique date de 1866), la Commune ne peut plus être appréhendée comme exclusivement franco-française (une guerre civile) ; comme le montre Quentin Deluermoz, elle « fait partie des grands événements médiatiques mondiaux de la seconde moitié du XIXe siècle ». Des États-Unis à l’Espagne, de la Roumanie au Mexique, l’auteur nous invite à sonder le regard porté par d’autres, la manière dont ils s’en emparent.
Données nouvelles
La concomitance de l’insurrection kabyle fait apparaître les décalages entre l’idéal d’émancipation des communards et leur attitude coloniale – l’exemple de la Commune d’Alger est particulièrement parlant – qui préfigure celle des communards déportés en Nouvelle-Calédonie participant à la répression du soulèvement Canaque (à l’exception de Louise Michel). Toutes ces données nouvelles sont riches d’informations et très évocatrices. Peut-être manque-t-il le regard russe qui me semble par trop négligé : le fondateur du mouvement des Narodniki (populistes), Piotr Lavrov sera le passeur de l’expérience de la Commune qui fascina Lénine, à la suite de Marx. C’est bien le communisme russe qui captera l’expérience de la Commune et entretiendra son souvenir – le dernier Communard mourant en URSS.
Quentin Deluermoz interroge ces soixante-douze journées : comment fonctionna en pratique l’administration d’une ville qui venait de subir le long siège que l’on sait ? Qui étaient les hommes amenés à remplacer les fonctionnaires partis pour Versailles ? Quelles furent les propositions de réformes et furent-elles appliquées ? Dans ce dernier champ, l’auteur reconnaît le peu de réalisations – question de temps – mais sans s’interroger sur leurs portées réelles (il n’y eut qu’un atelier vraiment autogéré, signale-t-il). Il est difficile de cerner quel fut le vécu de cette population amputée de 600 000 départs après le 18 mars, tandis que 52 % des restants s’abstinrent aux élections du 26 mars. Constat que résume Jacques Rougerie : « Tout Paris était loin d’être “rouge”, je ne le soulignais pas assez2. »
Les ouvriers avec la Commune ?
Voilà qui nous ramène à des analyses plus prosaïquement « politiques ». On pourrait croire, en lisant Quentin Deluermoz, que les ouvriers de l’artisanat parisien étaient unanimement favorables à la Commune. Un journal éphémère : Le Prolétaire, nous parle du comportement d’ouvriers récalcitrants, refusant de rejoindre les combattants, « jeunes gaillards » d’un atelier de chaudronnerie de la rue Saint-Maur narguant « sans cesse tous les gardes nationaux du quartier, parce qu’ils vont, disent-ils, se faire tuer comme des niais ». À la date du 24 mai, ce journal rapporte que des « jeunes gens plus ou moins moblots […] la plupart désœuvrés » disent : « Je marcherais bien avec tel bataillon mais on s’y soûle trop », « je trouve que les chefs ne sont pas assez sérieux ». La question de la nature de l’engagement dans la Garde nationale (la solde ?) est posée ; elle aurait mérité d’être approfondie car l’auteur semble verser dans l’exaltation d’une démocratie directe bien difficile à saisir lorsqu’il assimile certains bataillons de la Garde nationale à de « véritables républiques locales ». Ne faudrait-il pas prendre en considération les critiques portées par les ex-communards eux-mêmes tels Jean Allemane et Jules Andrieux ? Ils stigmatisaient avec violence le côté « armée d’opérette » aux états-majors pléthoriques, empanachés et incapables. Par là, se glissent d’autres clivages que la seule adhésion à l’idéal de la Commune. Comme sous le siège de la capitale, à l’époque de la défense nationale gambettiste, le « mirage des mots », la croyance qu’une « proclamation héroïque tiendrait lieu d’armée organisée3 », ne pouvaient remplacer une vraie défense de la ville insurgée – les failles du système des barricades en sont une des preuves. Face à Versailles, la temporalité de la Commune cherchant à promouvoir des réformes fut toujours en retard sur la marche des événements. Et ce n’est pas la résurgence des « méthodes » de 1793, avec un nouveau Comité de salut public, qui pouvait y remédier. Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’atmosphère régnant à Paris, dans cet espace « à la fois politisé et politisant », perçue comme placée sous le signe de la liberté et de l’initiative populaire avec ses fêtes qui, bientôt, laissèrent la place aux cérémonies funèbres, pour la simple raison que l’on ne peut éviter de s’interroger sur une sorte de fièvre paranoïaque qui, saisissant certains Parisiens, devait aussi ronger les organes dirigeants de la Commune : Renoir, peignant sur les quais, fut pris pour un espion et ne dût sa survie qu’à l’intervention de Raoul Rigault qu’il avait lui-même sauvé de la prison sous l’Empire… Et que dire des dénonciations après la Semaine sanglante ?
Une part insaisissable
L’histoire de la Commune invite à une grande humilité – mais n’est-ce pas le cas de tout mouvement social qui recèle toujours une part d’insaisissable ? Quentin Deluermoz nous le rappelle : « Avec ces 72 jours, la Commune est avant tout un mouvement, révolution en train de se faire, brutalement interrompue. C’est pourquoi il est impossible de l’assigner à une signification simple ou arrêtée. » Bien entendu, l’image diffusée par les gouvernants au pouvoir ne surprend pas : cette fois-ci sont dénoncés « les barbares qui réduisent en cendre les fruits lentement accumulés du génie humain », ils se sont emparés de la capitale alors qu’en 1831 ils campaient à leurs portes4. C’est une évidence : « Les lectures de la Commune restent marquées par une multiplicité des voix et de clivages politiques, sociaux ou culturels ».
Alors que nombre d’historiens s’essaient à l’uchronie, on peut se demander si avec une Commune ayant pris une autre forme et évitant la guerre civile, le mouvement ouvrier ne se serait pas développé sans le frein de la répression, plaçant ainsi le mouvement ouvrier français à l’égal de la social-démocratie allemande, ce qui aurait signé l’échec du souhait que Marx, estimant la classe ouvrière allemande supérieure à la française « tant sur le plan théorique que sur celui de l’organisation », exprimait le 20 juillet 1870 à Engels : « Ces Français ont besoin d’une raclée. Si les Prussiens l’emportent, la centralisation du pouvoir d’État favorisera la centralisation de la classe ouvrière allemande. La suprématie allemande déplacerait en outre le centre de gravité du mouvement ouvrier ouest-européen en le transférant de France en Allemagne. »
Ainsi le grand intérêt du livre de Quentin Deluermoz trouve sa source dans la réactivation des questionnements oubliés par l’inexorable marche du temps.
Jean-Louis Panné
1. En prévision de ce centenaire, Léon et Annette Centner, qui dirigeaient les Éditions d’histoire sociale, avaient réimprimé plusieurs titres sur la Commune dont Malon, Lefrançais, Guesde, Jeanneret mais ces tirages limités (mille exemplaires) ne furent pas épuisés avant longtemps – ce qui en dit long sur l’écart entre vision idéalisée et histoire. Pour une première approche, je recommande Sébastien Haffner, La Commune de Paris, Éditions de Fallois/Europlis, 2019. Cf. L’OURS, 489.
2. J. Rougerie, Paris libre 1871, Le Seuil-Histoire, 2004. préface à la réédition de l’ouvrage paru en 1971.
3. Ces remarques fort pertinentes, je les emprunte au livre méconnu du Dr Lucien Nass, Le Siège de Paris et la Commune. Essai de pathologie historique, Plon, 1914.
4. Saint-Marc Girardin, écrivait dans le Journal des débats, à propos de l’insurrection des Canuts : « Aujourd’hui, les Barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie ; ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. »