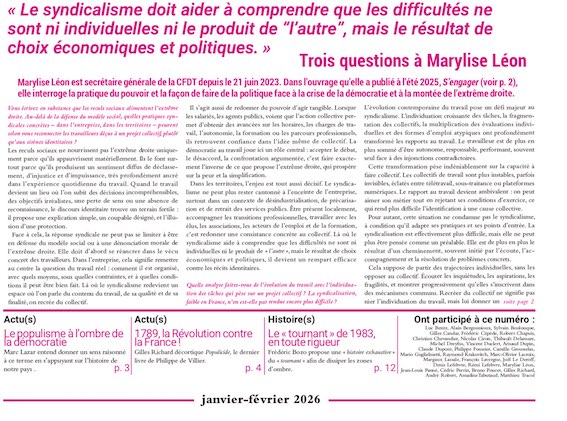Marylise Léon est secrétaire générale de la CFDT depuis le 21 juin 2023. Dans l’ouvrage qu’elle a publié à l’été 2025, S’engager (voir p. 2), elle interroge la pratique du pouvoir et la façon de faire de la politique face à la crise de la démocratie et à la montée de l’extrême droite.
Vous écrivez en substance que les reculs sociaux alimentent l’extrême droite. Au-delà de la défense du modèle social, quelles pratiques syndicales concrètes – dans l’entreprise, dans les territoires – peuvent selon vous reconnecter les travailleurs déçus à un projet collectif, plutôt qu’aux sirènes identitaires ?
Les reculs sociaux ne nourrissent pas l’extrême droite uniquement parce qu’ils appauvrissent matériellement. Ils le font surtout parce qu’ils produisent un sentiment diffus de déclassement, d’injustice et d’impuissance, très profondément ancré dans l’expérience quotidienne du travail. Quand le travail devient un lieu où l’on subit des décisions incompréhensibles, des objectifs irréalistes, une perte de sens ou une absence de reconnaissance, le discours identitaire trouve un terrain fertile : il propose une explication simple, un coupable désigné, et l’illusion d’une protection.
Face à cela, la réponse syndicale ne peut pas se limiter à être en défense du modèle social ou à une dénonciation morale de l’extrême droite. Elle doit d’abord se réancrer dans le vécu concret des travailleurs. Dans l’entreprise, cela signifie remettre au centre la question du travail réel : comment il est organisé, avec quels moyens, sous quelles contraintes, et à quelles conditions il peut être bien fait. Là où le syndicalisme redevient un espace où l’on parle du contenu du travail, de sa qualité et de sa finalité, on recrée du collectif.
Il s’agit aussi de redonner du pouvoir d’agir tangible. Lorsque les salariés, les agents publics, voient que l’action collective permet d’obtenir des avancées sur les horaires, les charges de travail, l’autonomie, la formation ou les parcours professionnels, ils retrouvent confiance dans l’idée même de collectif. La démocratie au travail joue ici un rôle central : accepter le débat, le désaccord, la confrontation argumentée, c’est faire exactement l’inverse de ce que propose l’extrême droite, qui prospère sur la peur et la simplification.
Dans les territoires, l’enjeu est tout aussi décisif. Le syndicalisme ne peut plus rester cantonné à l’enceinte de l’entreprise, surtout dans un contexte de désindustrialisation, de précarisation et de retrait des services publics. Être présent localement, accompagner les transitions professionnelles, travailler avec les élus, les associations, les acteurs de l’emploi et de la formation, c’est redonner une consistance concrète au collectif. Là où le syndicalisme aide à comprendre que les difficultés ne sont ni individuelles ni le produit de « l’autre », mais le résultat de choix économiques et politiques, il devient un rempart efficace contre les récits identitaires.
Quelle analyse faites-vous de l’évolution du travail avec l’individuation des tâches qui pèse sur un projet collectif ? La syndicalisation, faible en France, n’en est-elle pas rendue encore plus difficile ?
L’évolution contemporaine du travail pose un défi majeur au syndicalisme. L’individuation croissante des tâches, la fragmentation des collectifs, la multiplication des évaluations individuelles et des formes d’emploi atypiques ont profondément transformé les rapports au travail. Le travailleur est de plus en plus sommé d’être autonome, responsable, performant, souvent seul face à des injonctions contradictoires.
Cette transformation pèse indéniablement sur la capacité à faire collectif. Les collectifs de travail sont plus instables, parfois invisibles, éclatés entre télétravail, sous-traitance ou plateformes numériques. Le rapport au travail devient ambivalent : on peut aimer son métier tout en rejetant ses conditions d’exercice, ce qui rend plus difficile l’identification à une cause collective.
Pour autant, cette situation ne condamne pas le syndicalisme, à condition qu’il adapte ses pratiques et ses points d’entrée. La syndicalisation est effectivement plus difficile, mais elle ne peut plus être pensée comme un préalable. Elle est de plus en plus le résultat d’un cheminement, souvent initié par l’écoute, l’accompagnement et la résolution de problèmes concrets.
Cela suppose de partir des trajectoires individuelles, sans les opposer au collectif. Écouter les inquiétudes, les aspirations, les fragilités, et montrer progressivement qu’elles s’inscrivent dans des mécanismes communs. Recréer du collectif ne signifie pas nier l’individuation du travail, mais lui donner un cadre collectif intelligible. Le syndicalisme de demain ne sera pas un retour à des formes anciennes d’engagement, mais un syndicalisme capable d’accueillir des engagements différenciés, parfois intermittents, et de reconstruire du commun à partir de situations de travail fragmentées. Là encore, le travail réel est la clé d’entrée.
Votre parcours lie étroitement conditions de travail et défense de l’environnement. Quels sont les combats concrets qui pourraient aujourd’hui faire converger lutte sociale et transition écologique, tout en répondant à ce que vous appelez « la nécessité de placer haut la question sociale et valoriser le travail réel » ?
La transition écologique ne pourra réussir si elle est perçue comme une contrainte supplémentaire imposée à des travailleurs déjà fragilisés. Elle ne pourra réussir que si elle est pensée comme une opportunité de transformation du travail, et non pas comme un simple ajustement technico-économique.
Il n’y a pas de transition écologique juste sans justice sociale, et il n’y a pas de justice sociale durable sans prise en compte des enjeux environnementaux. Mais pour que cette convergence fonctionne, il faut placer la question sociale très haut, et partir du travail tel qu’il est réellement exercé.
Les combats concrets sont nombreux. Il s’agit d’abord d’anticiper les transformations des métiers, d’accompagner les reconversions et de sécuriser les parcours professionnels, plutôt que de laisser les salariés subir les mutations. Il s’agit ensuite de refuser que les secteurs dits « verts » reproduisent les travers du modèle qu’ils sont censés dépasser : précarité, sous-traitance massive, dégradation des conditions de travail.
La question du sens du travail est ici centrale. Beaucoup de travailleurs aspirent à contribuer à une activité socialement et écologiquement utile, mais se heurtent à des organisations du travail incohérentes, dominées par le court terme. Valoriser le travail réel, c’est reconnaître l’expertise des salariés, leur capacité à identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les processus de transition.
Enfin, la convergence entre social et écologique suppose une approche profondément démocratique. Les politiques écologiques perçues comme punitives ou déconnectées du réel sont rejetées, y compris par ceux qui en subissent pourtant les effets. À l’inverse, une transition co-construite avec les travailleurs, à partir de leur expérience et de leurs savoirs professionnels, peut devenir un puissant levier de mobilisation collective.
Propos recueillis par l’OURS.