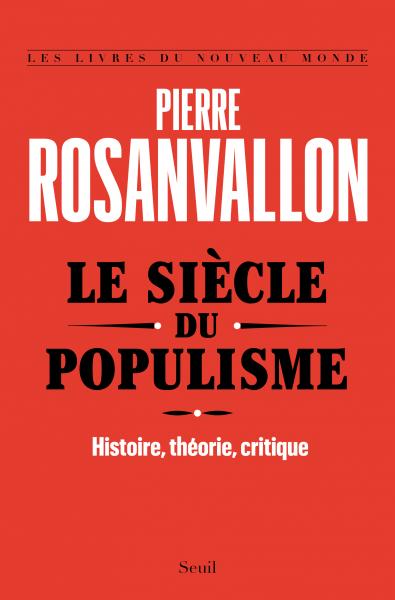Les contributions (revues, livres, colloques, conférences au Collège de France…) et initiatives de Pierre Rosanvallon animent le débat intellectuel et politique depuis la fin des années 1960. Son parcours combine réflexions idéologiques et engagements (CFDT, Parti socialiste jusqu’en 1981), de la Fondation Saint-Simon (1980-1990) à « La République des idées ». Il revient pour nous sur ce qu’est (et n’est pas) le populisme, objet de son dernier livre1. (entretien publié dans L’OURS n502, novembre 2020)
Comment définissez-vous le « populisme » ?
On peut donner trois définitions du populisme.
À l’évidence, le populisme est d’abord une réaction de colère et de mécontentement devant les dysfonctionnements de la démocratie.
En second lieu, c’est aussi un style politique qui se caractérise par l’importance qu’il accorde aux émotions. Voir dans le populisme un simple discours démagogique est réducteur. Les émotions en politique ne sont pas critiquables. Elles correspondent à une façon de comprendre et d’exprimer des choses compliquées. Et l’une des raisons de la force du populisme est précisément d’avoir réussi à trouver un langage des émotions pour parler des problèmes d’aujourd’hui.
En troisième lieu, si le populisme est fort, c’est également parce que c’est une culture politique. Il définit une conception de la démocratie, fondée sur une vision immédiate de cette dernière et par un rejet des corps intermédiaires (par exemple, des cours constitutionnelles ou des autorités indépendantes). Il renvoie aussi à une vision de la société coupée en deux, d’une part le peuple et d’autre part les élites. Enfin, c’est une conception de l’économie que l’on peut résumer par la formule « we want to take back control », qui exprime la nécessité de retrouver de la volonté en politique. Tout cela dessine, je dirais, un certain nombre de grands traits d’une culture politique qui, au-delà des divergences, se retrouve dans des pays ou chez des individus aussi différents que Orbàn, Trump, Poutine ou bien d’autres populistes latino-américains.
Pourquoi faut-il le « prendre au sérieux » aujourd’hui comme vous l’écrivez dans votre ouvrage ? Et comment y répondre ? Quelles critiques lui adresser et quelle réponse politique lui faire ?
Oui, il faut le prendre au sérieux, parce que le populisme n’est pas simplement l’expression d’une colère et d’un mécontentement. D’ailleurs, même s’il n’était que cela, il faudrait tout de même le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux parce qu’il propose une vision alternative de la démocratie. Orbàn le dit explicitement : ce qu’il veut, c’est une nouvelle définition de la démocratie, car à ses yeux la démocratie libérale a fait son temps. Poutine le dit également. Le populisme correspond donc selon moi à une sorte de challenge intellectuel : il appelle à redéfinir la démocratie et à ne pas se contenter d’une définition peut-être un peu paresseuse, celle de la démocratie parlementaire ou de la démocratie libérale.
C’est pour cela que, pour répondre réellement au populisme, on ne peut simplement se contenter de le stigmatiser. Il faut aussi proposer une conception à la fois du contrat social en démocratie, mais aussi de la démocratie, ainsi que de la volonté politique, qui soient profondément nouvelles par rapport à celles qui existent aujourd’hui. On ne peut se contenter de critiquer et d’attaquer le populisme en le dénonçant simplement comme le champion d’une démocratie illibérale, d’une démocratie tronquée. Certes, il est indéniable que les populistes défendent une démocratie illibérale, mais précisément ils s’en vantent. Il faut donc montrer que leur vision de la démocratie immédiate passant par des référendums quasi-permanents, et que leur critique des corps intermédiaires ou des cours constitutionnelles comme non démocratiques parce que non élues par le peuple, traduisent de manière insatisfaisante la volonté générale, la souveraineté et la représentation politique. Face à la difficulté de représenter une société morcelée et composite, ils se contentent de proposer la vision d’un leader qui en est en quelque sorte l’incarnation, c’est-à-dire, pour reprendre une formule bonapartiste, « un homme peuple ».
Pensez-vous que l’on puisse voir dans le gaullisme un populisme ?
Non le gaullisme n’est pas un populisme. Certes, il y a une dimension du chef charismatique dans le gaullisme, mais de Gaulle n’a jamais prétendu être l’incarnation du peuple. Il a d’abord et avant tout représenté un retour au premier plan du pouvoir exécutif et a ainsi, à mes yeux, anticipé la force que ce dernier allait prendre dans notre société moderne. C’est précisément à cause de cela que certains ont affirmé qu’il y avait dans le gaullisme une dimension bonapartiste. Souvenons-nous de la vision qu’en avaient Pierre Mendès France ou François Mitterand ; au fond, ce qu’ils voyaient en de Gaulle, c’était un apprenti dictateur ou du moins un partisan d’un régime autoritaire. C’est une erreur : pour moi, de Gaulle était d’abord un partisan de la prééminence du pouvoir exécutif. Les conditions de cette prééminence étaient liées, selon lui, non pas simplement au pouvoir exécutif, mais à la dégénérescence du pouvoir parlementaire. Il considérait que dans le monde moderne, il fallait redéfinir les pouvoirs et les contre-pouvoirs, que le vrai pouvoir devait être le pouvoir exécutif et que si on voulait des contre-pouvoirs, il fallait les opposer à ce dernier sous des formes nouvelles. De Gaulle, paradoxalement, on le sait, a été celui qui a donné un poids nouveau au Conseil constitutionnel. Certes, peut-être l’a-t-il fait pour de mauvaises raisons, pour limiter ainsi le pouvoir parlementaire. N’oublions pas qu’avant la Constitution de 1958 par exemple, c’était le Parlement qui validait les élections ; cela signfiait donc que les parlementaires validaient leurs propres élections. Certes, était-il juge et partie dans cette volonté de limiter les pouvoirs parlementaires, mais il n’en reste pas moins que c’est lui qui a contribué à attribuer un véritable rôle au Conseil constitutionnel. Même si ensuite, naturellement, d’autres étapes ont été franchies : avec le septennat de Giscard d’Estaing, puis plus récemment avec l’adoption de la question prioritaire de constitutionnalité. La montée en puissance du pouvoir exécutif s’est faite progressivement mais, même si c’est peut-être pour des raisons un peu paradoxales, de Gaulle a été à l’origine de ce mouvement.
De Gaulle est-il une figure du populisme ? Non, il représente une figure du pouvoir exécutif. C’est une figure aussi d’une réflexion sur la nécessité d’un nouveau rapport entre les pouvoirs parce que ce qui caractérisait les débuts du gaullisme, c’est la confrontation à l’état d’exception face auquel le pouvoir exécutif était la seule réponse possible. Aujourd’hui, nous retrouvons des sociétés qui se caractérisent par des circonstances exceptionnelles qui tendent à devenir sinon permanentes, du moins, très fréquentes. Et c’est ce qui justifie un rôle nouveau pour le pouvoir exécutif. Bien sûr, cela signifie qu’il faut aussi réinventer les anciennes fonctionnalités parlementaires : celles d’enquête, celles de délibération, de surveillance, de contrôle et celle de mise en responsabilité du pouvoir. Aujourd’hui toutefois, paradoxalement, le Parlement n’apparaît plus comme l’instrument « parfait » pour réaliser ces différentes fonctionnalités car sa coupure interne entre partisans et adversaires du pouvoir fait qu’il a comme fonction principale soit de soutenir, soit de critiquer le pouvoir. Certes, il faut aujourd’hui que le Parlement retrouve un certain nombre de ces fonctionnalités, mais il ne pourra pas les porter seul. De nouvelles institutions devront ici être inventées. Quand on parle, par exemple, de développer des conseils citoyens, c’est une façon d’élargir la délibération politique. Lorsqu’on met en place des institutions de contrôle, de surveillance de la corruption, comme je l’ai fait moi-même, en France en étant l’un des fondateurs de Transparency International, on participe à cette fonctionnalité de contrôle, à côté de la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (il est d’ailleurs prévu que des institutions de la vie civile, comme Anticor ou Transparency Internationalpuissent contribuer à son travail).
Vous voyez donc que la critique qui fait du gaullisme un populisme est beaucoup trop forte. Il faut penser de Gaulle comme un nouvel architecte des pouvoirs avec – à cause des circonstances et peut-être aussi de son tempérament – une prééminence donnée au pouvoir exécutif. Il avait certes le tempérament d’un leader charismatique, mais il n’avait pas le comportement d’un Orbàn, ni d’un Trump ou d’un Mélenchon. C’est pour cette raison que la comparaison avec eux n’est pas complètement valide.
Propos recueillis par Isabelle This-Saint-Jean
- Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Seuil, 2020, 279 p. Cf. le compte rendu par Alain Bergounioux (L’OURS 496, fév. 2020).