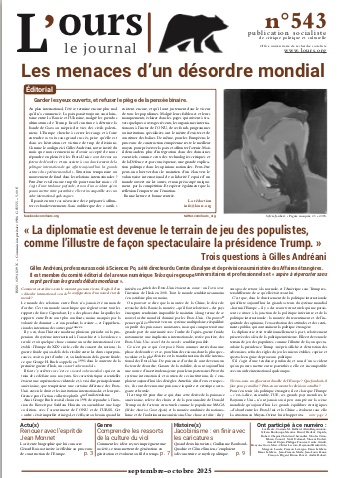Gilles Andréani, professeur associé à Sciences Po, a été directeur du Centre d’analyse et de prévision au ministère des Affaires étrangères. Il est membre du comité éditorial de la revue numérique Telos qui regroupe universitaires et professionnels et « aspire à répercuter sans esprit partisan les grands débats mondiaux ». (L’ours 543, sept-octobre 2025, p. 1-2)
Comment caractérisez-vous le moment que nous vivons. S’agit-il d’un « désordre international » ou de la configuration d’un nouvel état du monde ?
Le monde des relations entre États n’a jamais été un monde d’ordre. C’est un monde anarchique que règlent avant tout les rapports de force. Cependant, il y a des phases dans lesquelles les rapports entre États sont plus confiants, moins marqués par la volonté de dominer – et son pendant, la crainte –, et l’appréhension des intentions des autres puissances.
Il y a eu, dans l’histoire moderne, plusieurs périodes où la propension du système international à l’anarchie et à la violence a reculé et où quelque chose comme un ordre international s’est établi : l’Europe du XIXe siècle, celle du concert des nations ; la guerre froide qui, au-delà de la rivalité entre les deux superpuissances, avait sa part d’ordre ; et, au lendemain de la guerre froide, ce que George H. Bush a appelé, en 1991 dans le contexte de la première guerre d’Irak, un « nouvel ordre mondial ».
Il faut s’y arrêter car c’est ce « nouvel ordre mondial » qui est en train de se défaire sous nos yeux. Ses caractéristiques essentielles étaient une suprématie occidentale et, à vrai dire, principalement américaine, que tempéraient une certaine déférence des États-Unis envers le droit et les institutions internationales, et leur préférence pour l’action collective plutôt que l’unilatéralisme.
Ainsi George Bush avait-il choisi en 1991 de répondre à l’invasion du Koweït par Saddam Hussein en assemblant une large coalition, avec l’assentiment de l’ONU et de l’URSS. Cet « ordre » était imparfait et inégal, et s’effaçait au besoin quand les intérêts essentiels des États-Unis étaient en cause : on l’a vu avec l’invasion de l’Irak en 2003. Tout le monde semblait néanmoins s’en satisfaire plus ou moins.
On pouvait se dire que la montée de la Chine, le désir de revanche de la Russie, la montée – qu’il faut relativiser – des pays émergents rendraient impossible le maintien à long terme de ce nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. On pouvait penser qu’il évoluerait vers un système multipolaire, rééquilibré au profit des puissances montantes, mais qui comporterait une grande part de continuité avec l’ordre de l’après-guerre froide, notamment une implication internationale, restée positive, des États-Unis. Un « nouvel état du monde » semblait possible.
Ce n’est pas ce qui s’est passé. Nous sommes entrés dans une phase de désordre ; et ce, pour bien des raisons, dont la plus spectaculaire et la plus décisive est la transformation du rôle international des États-Unis. De puissance d’ordre, ils sont devenus un facteur de désordre. Garants de la stabilité, ils sont aujourd’hui une source d’incertitude majeure pour leurs partenaires. Pivot du système international et soutien de ses institutions, ils s’emploient aujourd’hui à les dérégler. Autrefois sûrs d’eux et respectés, ils sont devenus une puissance inquiète et erratique, arrogante et brutale.
Il est trop tôt pour dire ce qui, dans cette dérive de la puissance américaine, relève des choix et de la personnalité de Donald Trump ou de facteurs structurels comme le populisme MAGA (Make America Great Again) et la montée combinée du nationalisme et de l’isolationnisme américains. Une chose est sûre : il n’y aura pas de retour à la normale, et l’Amérique sans Trump restera différente de ce qu’elle était avant lui.
C’est que, dans le durcissement de la politique internationale qui affecte aujourd’hui les grands acteurs du système mondial – hormis l’Europe – il y a des ressorts structurels qui me paraissent se situer à la jonction de la politique intérieure et de la politique internationale : la montée du ressentiment et de l’inquiétude des opinions, l’exacerbation des attitudes et des sentiments publics, qui contaminent la politique étrangère.
La diplomatie était traditionnellement à part, relativement préservée des aléas de la politique intérieure. Elle est devenue le terrain de jeu des populistes, comme l’illustre de façon spectaculaire la présidence Trump : mépris affiché et détestation des adversaires, refus des règles du jeu les mieux établies, caprice et spectacle en guise de processus politique.
S’il s’agit d’une tendance profonde, et non d’un accident qu’on pourra mettre entre parenthèse, elle est incompatible avec un ordre international quelconque.
Vivons-nous un effacement durable de l’Europe ? Que faudrait-il faire pour y remédier ? Peut-on surmonter les divisions actuelles ?
Pour s’en tenir à la politique étrangère, il est clair que l’Europe – c’est-à-dire, ensemble, l’UE, ses grands pays membres, le Royaume Uni – n’ont jamais aussi peu compté sur la scène mondiale qu’aujourd’hui. Les grands équilibres stratégiques – d’abord entre les États-Unis et la Chine – évoluent sans elle. La situation au Moyen-Orient lui échappe totalement : les grands acteurs régionaux – Israël, la Turquie – y agissent à leur guise, sans égard aucun pour ce que peuvent penser les Européens.
Même dans les domaines où l’UE dispose de prérogatives institutionnelles qui lui permettraient en théorie de faire jeu égal avec les États-Unis, comme le commerce international ou la régulation de l’IA, ses membres les plus réticents à la confrontation avec les États-Unis, comme l’Allemagne ou l’Italie, ont prévalu.
Il n’y a que sur l’Ukraine que les Européens sont apparus assez profondément unis dans leur soutien à Kiev et dans leur résistance à la Russie. Unité inattendue, mais bienvenue. Ils ont forgé cette unité sous la présidence Biden, et autour des États-Unis. Il reste à voir s’ils seront capables de la maintenir alors que Donald Trump épouse largement les thèses russes et a cessé d’aider matériellement l’Ukraine. La perspective d’être laissés par les États-Unis seuls face à la Russie est, pour les Européens, vertigineuse.
Attachés à l’ordre ancien, qui leur convenait, la majorité des responsables européens sont, face à cette perspective, dans le déni et dans l’esquive : ils ne veulent pas voir que la relation transatlantique n’est plus la même, et préfèrent rentrer dans le jeu de Trump, dans l’espoir de l’influencer, plutôt que de s’opposer à lui.
L’Ukraine devrait logiquement sonner le glas de cette double illusion. En cas d’accord entre Trump et Poutine, en effet, il est probable qu’il soit si déséquilibré en faveur des Russes que les limites de leur tactique n’apparaissent en pleine lumière aux Européens.
Que feront-ils ? De cette épreuve peut sortir pour l’Europe soit une nouvelle humiliation, soit un ressaisissement. Cependant, l’unité autour du soutien à l’Ukraine sera plus difficile à maintenir s’il s’agit de la maintenir contre les États-Unis, car la relation avec l’Amérique divise l’Europe depuis toujours. Et n’oublions pas que les forces populistes et pro-russes sont puissantes en Europe.
On ne peut en tout cas sous-estimer l’importance de la question ukrainienne pour les Européens : les choix qu’ils feront définiront pour longtemps leur relation, non seulement avec la Russie, mais avec les États-Unis. Avec la Russie, c’est leur sécurité qui se joue ; avec les États-Unis, leur dignité et leur indépendance.
Quelles prospectives peut-on envisager sur l’évolution de la confrontation entre les États Unis et la Chine ?
Depuis trois quarts de siècle, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Ils appréhendent la montée de la Chine et craignent qu’elle ne parvienne au même rang qu’eux, voire qu’elle les dépasse. Dans les années 1970, à l’apogée de la détente avec l’URSS, les Américains avaient concédé aux Russes une double parité, stratégique et de statut politique, qui avait d’ailleurs fait craindre à l’Europe que n’émerge à ses dépens un condominium russo-américain.
Ils ne l’avaient fait que parce qu’ils y étaient obligés par leur relation nucléaire avec l’URSS, mais ils ne s’y étaient jamais résignés. À la différence des Européens, les Américains n’ont jamais eu l’expérience d’une politique internationale vraiment pluraliste, où ils ne seraient qu’un pays parmi d’autres. Ils se sont toujours perçus soit à part, soit au-dessus des autres. Ils auront le plus grand mal à s’ajuster à un monde d’égaux : c’est le problème que leur pose la Chine.
L’Amérique, celle d’Obama et de Biden, comme celle de Trump, n’est pas prête à concéder à la Chine une parité semblable à celle que la détente leur avait fait reconnaître à l’URSS. Et cela d’autant plus que les fondements économiques et technologiques de la puissance chinoise sont autrement solides que n’étaient ceux de l’URSS !
Elle cherche donc à restreindre sélectivement l’accès de la Chine à certaines ressources-clés comme les micro processeurs les plus avancés et les équipements permettant de les produire. Elle resserre ses alliances en Asie, cherche à y adjoindre l’Inde, aimerait que l’Europe – qui a ses propres griefs, justifiés, contre le mercantilisme chinois – souscrive à sa politique chinoise. Elle n’exclut pas, en même temps, de dialoguer avec la Chine sur des sujets précis où leurs intérêts peuvent se rejoindre.
De leur côté, les Chinois voient dans cette attitude américaine un complot destiné à faire obstacle à leur aspiration légitime à continuer leur progression dans la richesse et la puissance. Or, héritiers d’une tradition millénaire qui fait de l’ordre politique un ordre hiérarchique, au-dedans comme au dehors, ils raisonnent précisément en termes de statut et de reconnaissance.
Ils veulent comme préalable à une relation restaurée avec les États-Unis, que ceux-ci s’engagent à respecter les lignes rouges des intérêts fondamentaux et de la souveraineté chinoise : Taïwan, Hong-Kong, les Ouïgours, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, l’accès sans restriction aux instruments de la croissance et, plus généralement, la considération due à la Chine, à ses intérêts essentiels et à son régime.
Sur ces bases, l’entente entre la Chine et les États-Unis est impossible. La confrontation directe, sauf accident, n’est guère probable ; en tout cas, ni la Chine ni les États-Unis ne la souhaitent : ce serait le saut dans l’inconnu, une prise de risque qu’ils chercheront à éviter autant qu’ils le pourront.
Mais il y a cette restriction importante : « sauf accident ». La Chine, sous Xi Jinping, se montre de plus en plus désinhibée dans la manifestation de sa force militaire dans son environnement immédiat – la mer de Chine du sud en particulier – qu’elle considère comme son domaine impérial.
De son côté, Donald Trump n’a aucun égard pour les lignes rouges de quiconque et peut très bien franchir celles de la Chine. Des frictions militaires et politiques sont à peu près inévitables dans ces conditions, dont les négociations commerciales actuellement en cours entre les deux pays donnent une figure dont on peut espérer qu’elle se répète dans d’autres domaines : confrontation, refus du compromis, mais à la fin, pas de montée aux extrêmes.
Propos recueillis par Alain Bergounioux