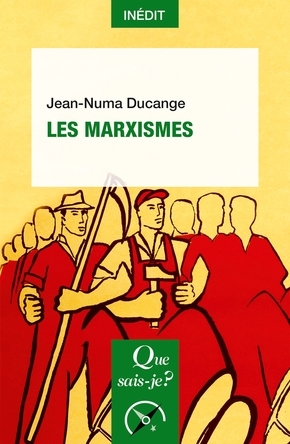Jean-Numa Ducange nous présente une excellente synthèse qu’on serait tenté de dire exhaustive. (a/s de Jean-Numa Ducange, Les marxismes, Puf, Que sais-je ?, 2025, 128p., 10€)
Le pluriel peut surprendre. Mais on pourrait relever les nombreux paradoxes que présente cette doctrine, dont, par exemple, la rigueur jugée monolithique n’a pas empêché un essaimage d’une grande diversité, dont il est courant de souligner l’échec global : « marxisme est aujourd’hui aussi le nom d’une défaite », affirmait Alain Badiou, en oubliant l’immense influence qu’il exerça sur le monde moderne, et dont, par ailleurs, la vocation émancipatrice s’est le plus souvent incarnée dans des régimes de nature totalitaire.
Une science et une religion
Ses succès, le marxisme les dut à sa double nature : il se présenta comme une science, le socialisme scientifique s’opposant aux socialismes « utopiques », mais il revêtit l’enveloppe d’une religion par ses méthodes et sa structure. À l’origine, on décèle trois sources : la philosophie allemande, avec Hegel au point de départ ; la politique française, avec ses révolutions – la « Grande » de 1789, celle de 1848, et la Commune ; enfin l’économie politique anglaise avec, entre autres, l’analyse des notions de force de travail ou de plus-value. La démarche marxiste se veut donc scientifique. Elle explique pourquoi le prolétariat devient l’élément moteur de la progression de l’humanité, et s’appuie sur la dialectique matérialiste pour montrer que l’infrastructure matérielle permet de comprendre les structures intellectuelles et juridiques d’une société. Le Capital de Marx, paru en 1867, est presque contemporain des Origines des espèces de Darwin, publié en 1859. La science sociale s’inscrit au cœur de la science biologique. Reste tout de même à rendre le déterminisme scientifique compatible avec la liberté humaine.
Mais le marxisme ne refuse pas de faire quelques emprunts à la religion catholique. Pour canaliser la spontanéité brouillonne du prolétariat, il a lui aussi besoin d’un encadrement assuré par une élite qui se constituera bientôt en avant-garde sans états d’âme. Les références sont éloquentes. Jean Longuet, petit-fils de Marx, évoque « la catholicité » du socialisme, et Jules Guesde publie, en 1878, un Essai de catéchisme socialiste.
Européen occidental dans son origine, le marxisme va rapidement au-devant d’autres horizons. Un autre paradoxe, c’est qu’une doctrine reconnaissant un rôle de guide au prolétariat, s’impose dans des pays à forte majorité rurale. À commencer par la Russie, dont Marx, à la fin de sa vie, reconnaitra qu’elle pourrait s’appuyer sur ses traditions communautaires traditionnelles pour aller au socialisme. Il fallut aussi constater que les premières révolutions du XXe siècle éclataient dans de vastes ensembles imprévus : l’Iran, la Turquie, la Russie en 1905, la Première République chinoise…
Hérésies et nouveaux modèles
Puis vint la victoire des bolcheviks en 1917. Désormais, la ligne définie prenait exclusivement en compte les intérêts de la maison mère. Et, comme dans toute Église, apparurent les hérésies. Des hérésies déclarées, comme le trotskisme qui évoquait « un État ouvrier dégénéré », ou l’école de Francfort, avec Horkeimer ou Adorno. D’autres théoriciens, tels Gramsci ou Lukacs, restaient orthodoxes, mais non sans se livrer à un effort hardi de modernisation. Avec la dissémination de la doctrine dans le monde, le pluriel « les marxismes » prenait tout son sens.
De nouveaux modèles émergeaient, de Belgrade à Pékin, en passant par Tirana. Ils divergeaient du modèle matriciel, en affirmant, par exemple, le caractère révolutionnaire de la paysannerie. Au tournant du demi-XXe siècle, on peut, comme Ducange, parler d’ « apogée paradoxal » du marxisme dans le monde. Il est évoqué partout, mais fortement bousculé. Il se retrouve dans toutes les activités intellectuelles, mais il doit affronter, et souvent avec difficulté, de nouvelles problématiques : la décolonisation, la revendication autogestionnaire, le féminisme, l’expansion de la psychanalyse, la vague écologiste… À chaque fois, le marxisme est convoqué, parfois adapté, parfois brutalement congédié. Malmené, mais jamais oublié.
Et puis l’auteur nous rappelle que, malgré la brouille originelle, les réformistes socialistes ont brocardé « le blanquisme à la sauce tartare » sans pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain. Contrairement à l’idée reçue, le congrès de Bad Godesberg, en 1959, a rejeté le marxisme associé au stalinisme, mais a maintenu sa référence à Marx. À l’image du PS d’Épinay, un certain nombre de socialistes européens ont cherché à concilier Marx et Keynes.
Il est vrai qu’après l’éclatement de l’URSS, les marxismes constituent un « ensemble d’archipels politiques et intellectuels » qui offrent beaucoup moins de perspectives conquérantes. Toutefois, Jean-Numa Ducange rappelle opportunément que tous reconnaissent la forte empreinte que le marxisme a posée sur le monde. Un adversaire aussi résolu que Raymond Aron soulignait dans les années 60 que, si le marxisme venait à disparaitre, « il n’y aurait pas un système aussi complet pour occuper sa place ».
Claude Dupont
Article paru dans L’ours 541 mai-juin 2025
Claude Dupont