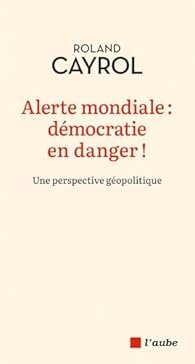Roland Cayrol, politologue, est un spécialiste de la vie politique française. Il vient de publier Alerte mondiale : démocratie en danger ! Une perspective géopolitique (éditions de l’Aube, 2025, 214 p., 18 €)
Comment expliquez-vous que l’on soit passé, au tournant des années 1980-1990, d’une espérance dans la diffusion des régimes démocratiques à l’échelle du monde à, aujourd’hui, à une extension des régimes autoritaires et à une crise de confiance dans les démocraties elles-mêmes ?
Il est vrai que, dans la période 1980-1990, un basculement s’est produit, qui a vu se développer les régimes autoritaires, et donc un déclin des démocraties. La démocratie est un combat, elle ne va pas de soi, elle est toujours menacée, elle peut toujours disparaître.
Les peuples ont, à partir de cette période – qui connaît toujours des prolongements aujourd’hui – douté de plus en plus de l’efficacité de la démocratie. Bien sûr, il y a eu des débats théoriques de principe autour de la démocratie. Mais l’important me paraît être ce doute populaire sur les capacités des démocraties à affronter les crises, et à répondre concrètement aux attentes des citoyens. Dans l’affrontement entre démocratie et autorité, on s’est volontiers mis à penser – surtout parmi les catégories populaires – que les formations démocratiques perdaient leur temps en débats et en hésitations, n’étaient même plus capables de se rendre compte des demandes citoyennes, et qu’il était donc nécessaire de restaurer de l’autorité, de donner un coup de pied dans la fourmilière, de mettre de l’ordre et de s’affronter aux problèmes de l’heure avec efficacité.
Les mouvements autoritaires ont alors su inventer des méthodes et un discours populiste qui, précisément, savaient proposer des régimes qui additionneraient l’État fort (avec même encore souvent le culte du chef) et l’introduction du peuple, de ses besoins, de ses désirs, voire de ses rêves, dans la politique. Bien sûr, c’était un leurre ; bien sûr, les peuples n’ont en rien été invités à épouser la démarche des formations politiques autoritaires, mais cette illusion a été puissante.
Elle l’a été d’autant plus que la social-démocratie, la formation prédominante de la vie politique dans la plupart des pays concernés, n’avait plus rien à dire. La social-démocratie avait changé la vie des populations, notamment des classes laborieuses, avec un certain bonheur pendant des décennies, mais elle avait gagné, et elle avait ainsi rempli son programme. Son projet politique achevé, elle ne savait plus inventer de formules politiques nouvelles, aptes à répondre aux nouveaux espaces des demandes citoyennes. Merci et au revoir : la social-démocratie a été renvoyée à son passé. Les partis communistes connaissant de leur côté une critique croissante à partir des analyses et reportages terrifiants sur l’Union soviétique et les pays de l’Est européen, l’espace politique – et électoral – s’ouvrait aux autoritaires, ceux qu’on n’avait « jamais essayé ».
À l’évidence, il faut distinguer les évolutions dans le Tiers-Monde, les pays en développement, et le monde développé. Si tous ont vu naître les mêmes doutes envers la démocratie, les mêmes pulsions de populisme autoritaire, de nombreux pays d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie du Sud-est ont alors plongé de manière majoritaire dans l’autoritarisme, alors que, dans les pays développés, les régimes ont résisté. En Europe surtout, où le système de valeurs de la démocratie libérale était très ancré.
Aux États-Unis aussi, dans cette période, la démocratie semblait être la loi immuable. Beaucoup y voyaient même l’intangible modèle pour la démocratie mondiale. Il aura suffi de l’élection d’un Trump – avec un soutien électoral majoritaire – pour qu’en quelques mois, tout s’effondre. Les institutions et les pratiques fondamentales de la démocratie y sont bafouées ; on est tombé dans l’illibéralisme, certains diront, déjà, dans un régime autoritaire.
L’Europe occidentale, seule, résiste. Elle a pourtant connu les doutes et les poussées populistes des années 1980-1990, mais, pour le moment, elle a su les refouler. C’est dire combien notre responsabilité est grande, en Europe, de continuer à défendre et promouvoir les valeurs de la démocratie libérale : la partie n’est jamais gagnée.
Comment consolider les fondements de la démocratie libérale (les pratiques électorales, une justice respectée, le pluralisme de l’information etc.), à la fois au niveau de l’Union européenne, à laquelle vous donnez une grande importance, et au niveau national ?
Cela doit être un combat de tous les instants. Ce combat doit être mené par les personnes les plus concernées – par exemple les magistrats, les journalistes, les avocats, les élus, les comédiens – mais aussi par tous les citoyens. Je cite en premier les personnes « concernées », parce que, dans tous les pays démocratiques dans lesquels les nationaux-populistes essaient de marquer des points, ce sont les secteurs culturel, médiatique et judiciaire qui sont d’abord visés. On le voit aujourd’hui dans la Hongrie d’Orban, dans l’Italie de Meloni, dans l’Amérique de Trump, dans l’Argentine de Milei. Il est donc important que les professions de ces secteurs soient en première ligne pour défendre et affirmer les fondements de notre démocratie libérale. Mais il est essentiel qu’ils soient accompagnés et soutenus par les citoyens dans leur ensemble –, car c’est des citoyens que dépend le caractère massif de la résistance.
Évidemment, c’est là qu’on peut avoir des déceptions. J’ai parfois le sentiment que le peuple (et d’abord ses catégories les moins aisées) laisse faire les affronts à l’État de droit, laisse un Trump attaquer juges et universités sans broncher. C’est la même chose en Italie et en Hongrie – et aussi chez nous.
Ceux qui s’alarment des coups de canif à l’État de droit, de la part de l’État central ou de collectivités locales, dans le domaine culturel par exemple, me paraissent souvent peu nombreux, et limités aux personnes des professions concernées. Des professionnels de la profession, aurait dit Coluche. Or, c’est d’une mobilisation permanente pour les valeurs démocratiques que nous avons besoin, pour une véritable efficacité. Ces valeurs paraissent trop souvent « normales » aux citoyens ; elles semblent aller de soi, comme l’air que nous respirons. C’est faux : l’exemple de Trump le montre ; en moins d’un an, le socle entier de ces valeurs est détruit dans une bonne moitié du plus grand pays du monde.
Pour toujours requinquer ces valeurs, les exalter et les rafraichir, il faut l’effort de tous ceux qui s’engagent pour la démocratie – les militants des partis, syndicats, associations, les organes de presse, des enseignants et des éducateurs bien sûr. Et de toutes les bonnes volontés !
Quels sont les traits spécifiques de la crise démocratique française ?
Il est évident que le système présidentiel français, où un président tout-puissant est la clé de voûte du régime, pose problème à la démocratie. Il était sans doute bon que les citoyens se fussent dotés, par le référendum de 1962, du droit de choisir leur président, mais on ne peut qu’observer la dérive ultra-présidentialiste du régime. Je serais partisan d’un rééquilibrage des pouvoirs, et de la suppression du poste de Premier ministre.
Cela dit, nous sommes dans une période, nouvelle pour nous, de tripartition électorale entre trois blocs, et de déplacement du pouvoir à l’Assemblée nationale. Dans cette conjoncture, beaucoup ont insisté, à raison, sur le manque de culture du compromis en France. Nous avons vu, jusqu’ad vomitum, les résultats de ce manque de culture dans les relations entre partis à l’Assemblée : chacun proclamait sa soif de compromis, mais sur la seule base du programme de son parti !
On a prétendu que les Français, et leurs élus, étaient inaptes au compromis (qu’ils pratiquent pourtant dans tous les aspects de leur vie sociale). Je crois que les citoyens n’y sont pour rien : ils observent ces palinodies avec sévérité. Il me semble seulement qu’on pourrait plutôt améliorer la pratique politique. Par exemple, quand on conclut une alliance gouvernementale, cela se fait, dans la plupart des pays d’Europe, sur la base d’un indispensable accord écrit. C’est sur cette base qu’on nomme les ministres. En France, les quatre premiers gouvernements composés après les élections de 2024, l’ont été sans le moindre bout de papier, le Premier ministre désigné se contentant d’appeler des élus en leur demandant : « Veux-tu entrer dans mon gouvernement ? »
C’est donc d’abord sur des dispositifs constitutionnels de rééquilibrage des pouvoirs et sur la régulation des pratiques de compromis politique que résident, selon moi, les vraies spécificités françaises.
Propos recueillis par Alain Bergounioux