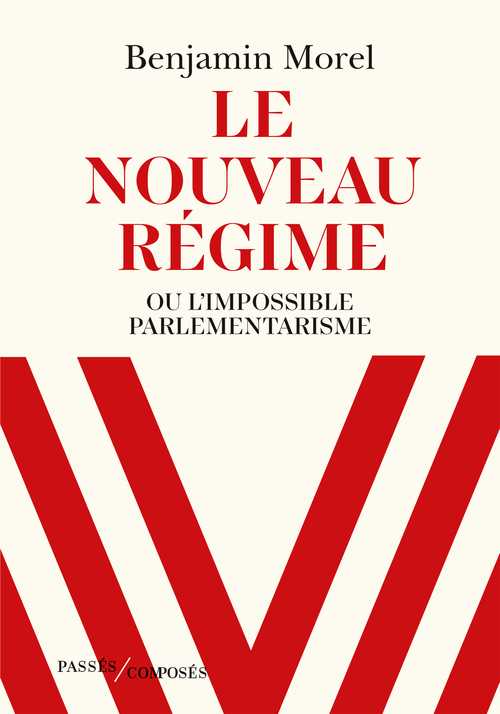Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférences à Paris II, dont nous analysons régulièrement les ouvrages (L’ours n°528 et L’ours 538), est très présent dans les médias pour intervenir sur les sujets ayant trait au fonctionnement de nos institutions et en particulier du Parlement. Ils sont légion depuis l’élection présidentielle de 2022 qui a vu naître une majorité relative à l’Assemblée nationale, mais également avec la censure du gouvernement qui s’en est suivie. (a/s de Benjamin Morel, Le Nouveau Régime ou l’impossible parlementarisme, Passés composés, 2025, 144 p., 16 €)
L’auteur propose comme à son habitude une lecture critique de la Ve République, à l’aune de ces évènements récents, qui ont affaibli le fait majoritaire propre à notre régime et abouti à une reparlementarisation de fait.
La nature du régime
Benjamin Morel rappelle que notre régime, présenté à tort comme semi-présidentiel, reste avant tout un parlementarisme rationalisé, pensé à l’origine par Michel Debré comme un équilibre ressemblant au modèle britannique, mais sans le pouvoir royal. Le tournant intervient véritablement en 1962, avec l’élection présidentielle au suffrage universel direct, qui confère un poids symbolique et politique inédit à la Présidence qu’il reste difficile de remettre en cause, même si la proposition fait régulièrement débat.
Toutefois, ce pouvoir présidentiel reste limité sur le plan juridique : le président ne rédige pas les lois, n’exerce pas le pouvoir réglementaire, et ses prérogatives en matière de défense et d’étranger sont encadrées, le Premier ministre et le gouvernement étant responsables devant le Parlement. Benjamin Morel dénonce le « spiritisme constitutionnel » : l’idée que les institutions auraient un « esprit » transcendant est une illusion. La preuve : même en l’absence de pouvoir juridique fort, le Président reste l’incarnation du pouvoir en France et, jusqu’à il y a peu, le chef de la majorité parlementaire.
La crise actuelle
Le cœur du propos réside dans la crise actuelle du parlementarisme face à un exécutif renforcé : la dernière dissolution (juin 2024) et la nouvelle configuration de l’Assemblée ont fait apparaître une fragmentation du débat parlementaire. Trois blocs – majorité présidentielle, RN, Nouveau Front populaire – coexistent sans majorité claire, générant « une ingouvernabilité chronique ». Cette situation complexifie fortement le fonctionnement parlementaire : incapacité à former des coalitions stables, usage accru de dispositifs exécutifs (49-3, recours à l’article 16, prolongement de gouvernements démissionnaires…), traduisant selon Benjamin Morel une pente potentiellement illibérale. Il alerte : ce ne sont pas les textes qui changent, mais leur interprétation pragmatique, susceptible d’ouvrir la voie à un « présidentialisme illibéral ».
Également, l’auteur critique l’hyperconcentration du pouvoir : renforcement du Conseil constitutionnel, multiplication des conseils de défense et nouvelles procédures administratives contribuent à diluer la responsabilité politique et limiter les contre-pouvoirs. Or, un organe n’est légitime à gouverner que lorsque ses actions sont perçues comme acceptables et mises en œuvre. Tant le président de la République que le gouvernement actuel ne sont perçus comme tels, ce qui renforce la défiance à leur égard et in fine, à l’égard de la démocratie.
Benjamin Morel démontre comment les réformes successives – quinquennat, calendrier électoral modifié en 2008, passage au scrutin proportionnel partiel – ont vidé les législatives de leur substance et réduit le Parlement à un rôle de chambre d’enregistrement, renforçant mécaniquement l’exécutif. Il nuance l’idée reçue selon laquelle les Français votent automatiquement pour donner une majorité au président : c’est souvent la démobilisation de l’adversaire qui produit cet effet, par le phénomène de la participation différentielle.
Redonner sa place au Parlement
En réponse, l’auteur propose une « reparlementarisation » du régime : renforcer les moyens et l’expertise parlementaire, alléger la dépendance administrative vis-à-vis de l’Élysée, promouvoir une coalition de gouvernement réellement responsable devant l’Assemblée. Il plaide aussi pour un scrutin plus proportionnel, facilitant la formation de majorités pluripartites plus représentatives et souples.
Mais, prévient-il, ces réformes institutionnelles seules sont insuffisantes : elles doivent être portées par un renouvellement démocratique fondé sur la responsabilité politique et l’intelligence citoyenne. Le cœur du défi français est de reconstruire la confiance dans le pouvoir politique : face au sentiment d’impuissance, les citoyens se tournent vers l’abstention, le repli communautaire ou le recours à des figures autoritaires. Là est le risque de l’impossible parlementarisme.
Sarah Kerrich-Bernard